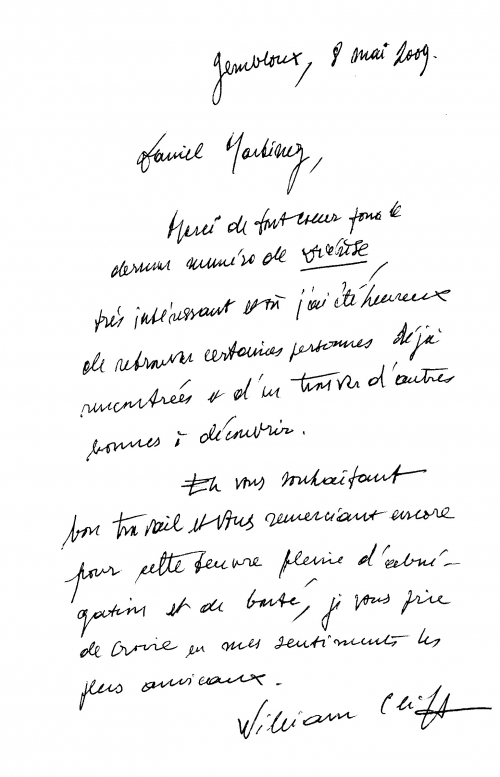"Mon Amérique" de Philippe Labro, éditions de La Martinière, octobre 2012, 232 pages, 30 €
Un bien beau livre à la couverture cartonnée, signé par l'auteur de "L'Etudiant étranger", avec le portrait de cinquante personnages illustres, dans le domaine littéraire, artistique, musical et politique, le tout agrémenté de photographies "qui parlent d'elles-mêmes" selon l'expression consacrée.
J'ai choisi pour vous ce que Philippe dit du plasticien Edward Hopper, un peintre que je situe haut dans mon panthéon pictural, une empathie tout simplement résumée par l'atmosphère que délivrent ses tableaux, inimitable. Si Yves Bonnefoy voit dans "The Lighthouse at Two Lights" "Le phare à deux feux" (1929) l'un de ses chefs-d'œuvre,