Auteurs
-
Charles Juliet est mort le 26 juillet 2024. Les éditions P.O.L travaillaient avec lui à l’édition du onzième volume de son Journal, à partir de l’année 2013. Il en avait décidé le titre : Mes meilleures années. Ce volume était encore en chantier avant sa disparition.
Rien d'apprêté dans ce dialogue à mots couverts entre l'auteur et le plasticien, qui se confie à lui, le plus librement, et sincèrement possible.
-
Claude Louis-Combet nous a quittés le 24 novembre 2025
Un auteur des plus étonnants que Claude Louis-Combet, que j'ai lu surtout à ses débuts, qui furent tardifs (il commence à publier à 38 ans, avec Infernaux Paluds) et c'est, pour celui qui écrit ces quelques lignes, un plaisir que de remonter dans le temps, en cet automne 1997 où Louis-Combet, parlant de lui-même en tant que narrateur, à la troisième personne du singulier définissait ainsi sa démarche, se référant à une expression à son sens "magique" : "depuis le commencement". Soit : "Le commencement de la phrase qui est le commencement du texte qui est le commencement d'un nouvel épisode d'écriture n'a valeur que de commencement relatif. On n'imagine pas un coureur sans disposer d'un point d'appui sous le pied. Ce point d'appui est occasionnel, accidentel – l'arête résistante et incitatrice d'une pensée, d'une émotion, d'un souvenir, quelquefois simplement d'un mot, d'une expression insistante et obsédante. A partir de là, le texte, construction et déploiement de l'existence aux prises avec elle-même, prend son essor." (revue Conférence n° 5, automne 1997). Ce texte, qui touche à l'auto-analyse, sera repris en novembre 1998 dans Le recours au mythe, chez José Corti.
C'est dans le tout premier numéro de Diérèse, paru le 21 mars 1998, que j'ai parlé, sans ambages, d'un livre de l'auteur qui nous intéresse, intitulé Larves et lémures, en pages 18 et 19 de la revue.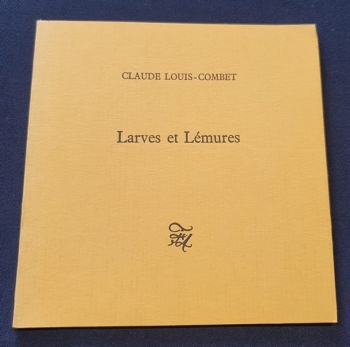
Je retranscris ce texte tel quel, en manière d'hommage :
-
"Six plus un remords pour le ciel", d'Odysseus Elytis, traduction de François-Bernard Mâche, avec une eau-forte de Jacques Hérold, éditions Fata Morgana, 6 octobre 1977, 40 pages, 400 exemplaires.
"Deuxième Prix Nobel grec (1979), après Georges Séféris (1963), Odysseus Elytis est sans doute un des poètes majeurs de la Grèce contemporaine. Sa réputation de « poète de la mer Égée » ne doit pas tromper. Ce n'est pas, bien entendu, dans la peinture statique du paysage grec ni dans la présence de quelques thèmes persistants (îles, mer, soleil, jeunes filles, etc.) que réside l'importance de cette œuvre polyvalente, mais dans un effort d'unité profonde où la poésie joint la nature, l'histoire et la liberté. Pur poète lyrique, Elytis combine l'acuité du regard avec la force de l'imagination et la fraîcheur du sentiment. En dernière analyse, le surréalisme ne lui a révélé qu'une aptitude qui lui était propre : celle d'unir et de transformer les choses à la fois."
J'ai choisi de vous donner à lire en ce jour des extraits d'un recueil du poète, paru peu avant l'attribution du Prix Nobel de littérature, et afin d'illustrer au passage l'un de mes propos constants : il n'y a pas de raison sérieuse (j'entends par là "poétique" et non idéologique) ou recevable pour que l'Hexagone, qui dans le temps portait haut la notion d'"exception culturelle" ait déconsidéré le lyrisme, le reléguant au rayon des vieilles lunes. Pour mémoire, Odysseus Elytis fut combattant de la guerre gréco-italienne (1940-1941), et cela nous vaudra la parution, en 1959, de son fameux Axion esti (ou : "Il est digne...", qui sont les deux premiers mots d'un hymne à la mère de Dieu dans la liturgie byzantine).
Il s'agit d'abord, pour le poète, de retrouver le sens d'une vie, d'enrichir et de renforcer la première notion qui nous vient de naissance : celui de la relation. Relation à l'autre bien sûr, mais aussi relation à la nature, qui de toute manière aura raison de nous (si nous ne nous autodétruisons pas avant). L'opposition classique et formelle entre nature et culture procède en fait d'un détournement de sens, manichéen d'esprit, car l'un ne va pas sans l'autre, même s'il nous appartient de modeler notre environnement par l'intelligence d'abord, maître mot il est vrai, mais pas exclusif. De ce combat multiforme où l'avers prend source dans l'apparence, et le revers se conjugue avec la plénitude, surgit le poème, sa force intérieure et extérieure tout à la fois.
Voici la première variante – dans une langue ici tragique, eschyléenne –, de l'une des sept sections qui composent Six plus un remords pour le ciel, intitulée :
