"L'Empreinte" : Pierre Bergounioux, éditions du Laquet & François Janaud, septembre 1997, 96 pages, 55 F
Pour Pierre Bergounioux, dont le Journal (couvrant les mois de juin et de juillet 2021) paraîtra in Diérèse 83, l'année 1997 est la plus riche en termes d'édition. Avec : La mort de Brune, Gallimard/Folio ; La ligne, Verdier ; L'empreinte, éditions du Laquet et François Janaud ; La demeure des ombres, éditions Art & Arts et Kpélié, éditions Flohic.
Le livre présenté ce jour, L'Empreinte, a été réédité quatre ans après une première édition à tirage limité de la maison François Janaud, ouvrage alors accompagné de lithographies d'Henri Cueco.
Signalons que les éditions du Laquet ont eu une durée de vie de 18 ans (1991-2009) ; leurs collections - (peut-être trop) riches en auteurs publiés - se voulaient l'équivalent de ce qu'a tenté Claude Michel Cluny avec la défunte collection Orphée des éditions de La Différence. Le prix de chaque ouvrage était abordable (11,50 € actuels), mais le support médiatique notoirement insuffisant... Ainsi fut.
Pour revenir au Journal de Pierre Bergounioux publié en Carnets chez Verdier depuis l'année 2007, voici la couverture de son premier opus, d'un jaune solaire autant que printanier, bien venu :
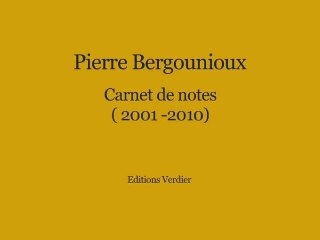
Je suis de Brive. Si j'ai mis longtemps à concevoir qu'on puisse naître ailleurs, vivre autrement, ce fut par la force des choses. Une officieuse main y avait travaillé dès l'âge permo-carbonifère, tandis que nous étions encore dans les limbes, à attendre. Elle avait disposé, en rond, des collines égales ou alors taluté le pied de la montagne limousine, au bord de l'Aquitaine, puis enfoncé le pouce à leur jointure. Peu importe.
Le cercle parfait, tracé à notre intention au fond des temps géologiques, était le premier signe de notre élection. Son relèvement, à la circonférence, bornait de tous côtés les regards. La ligne de faîte courait à égale distance du centre ville. On distinguait des prés, des arbres, les brouillards verts du premier printemps, le lait des fumées de l'automne. En quelques endroits bien précis, au pied de la nef de l'église Saint-Martin, vers le milieu de l'avenue de la gare, de la place de la Guierle, on prenait d'assez larges vues sur le ciel, la seule chose à faire un peu défaut, à cause des hauteurs, justement. On découvrait, sans qu'il fût besoin de lever la tête, le velum azuré des beaux jours, les grandes nefs blanches que pousse le vent d'ouest, les émaux de la bise, les vapeurs versicolores et les fusions que le plus âpre des vents tire d'on ne sait quel creuset.
Telle fut ma première faveur, le giron des collines, la protection qu'elles offraient contre l'inquiétude qui sourd des lieux ouverts, celle dont je fus transi, plus tard, à l'approche de Paris, sur les glacis de la Beauce, et plus tard, encore, dans les sables de Prusse. Il faut, pour prendre la mesure du monde, de vastes horizons. C'est dans la plaine allemande, sous les auspices conjugués de la solitude et de la guerre, de l'exil et de l'hiver, que Descartes a posé les principes de la connaissance vraie. On ne se sait être, un jour, ce que nous sommes, que pour avoir délaissé les îles parfumées, les clairières, les petites villes auxquelles des collines douces ont passé leur anneau. La réalité, quand on finit par l'envisager, afflige et désenchante. L'illusion qui en tenait lieu, d'abord, se pare d'un attrait rétrospectif d'autant plus sensible qu'on l'a perdue sans retour. Le vrai, dit quelque part quelqu'un dont on peut visiter la tombe, au cimetière de Dorotheestrasse*, à Berlin, c'est le tout et le tout, le vrai. Mais ça, ce fut après, quand j'avais quitté Brive et compris ma douleur ou, simplement, compris.
Avant, il en fut autrement. La conformation naturelle du lieu aidant, j'ai pu croire qu'il enfermait l'ensemble de la création ou que - c'est pareil - la somme de ce qui existe tenait dedans. J'ai pris le tout pour la partie et la partie pour le tout. J'ai connu la douceur de ne point connaître. J'ai été au monde purement et simplement. Certains se sont représenté la terre comme le dos d'une tortue, laquelle reposerait sur l'échine d'un dragon dont les mouvements provoquent les séismes. D'autres l'ont envisagée de mille autres manières à peine moins séduisantes où l'oiseau-lyre, Aldebaran, Altaïr, une pierre verte, certaine plante des déserts jouaient un rôle prépondérant. Ce n'est pas ça, pas exactement.
C'est, ce fut une cuvette que fermait, au nord, la muraille du Limousin, le vrai, le sombre, celui du granit et des fougères, du froid, des ciels émaillés comme la porcelaine de Limoges par les feux glacés de la bise. A peine avait-on passé le pont Cardinal, pris pied sur l'autre rive où la route de Paris attaque sans tergiverser l'abrupt versant, qu'on se sentait inquiet, inexplicablement. Lorsque je suis parti pour de bon et que je le savais, j'ai identifié la mélancolie spéciale qui rôde toujours à l'extrémité de l'ouvrage. C'était celle de l'exil.
Pierre Bergounioux
* en fait le cimetière de Dorotheenstadt, où fut enterré Hegel (ndlr)